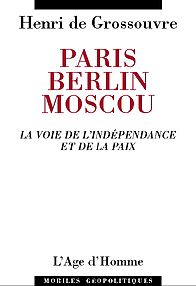"Les Hydrocarbures dans la politique étrangère russe, outil de coopération ou de coercition?"par Cyrille Gloaguen, de l'Institut Français de Géopolitique (Paris VIII).
Les hydrocarbures dans la politique étrangère russe : outil de coopération ou de coercition ?
Cyrille Gloaguen,
Institut Français de Géopolitique (Paris VIII)
Pour le vieux général conservateur L. Ivashov, ancien responsable de la coopération internationale de l’état-major général, la Russie ne doit pas hésiter à utiliser son « gaz, son électricité et ses réseaux de transport d’énergie » pour s’opposer à l’extension de l’Otan. V. Poutine, quant à lui, s’oppose à la privatisation de Gazprom, holding qui détient le quasi-monopole du transport du gaz en Russie, sous le prétexte qu’il est un « puissant outil d’influence politique et économique sur le reste du monde». Pour frappantes que soient ces déclarations, les deux hommes ont, en les prononçant, sans doute en tête des buts autres que politiques : Ivashov se prépare, à la tête de son parti, l’Union de la grande puissance militaire de Russie, aux législatives de décembre, tandis que le président s’oppose à la privatisation et au démantèlement d’un groupe qui, en finançant son parti, assure son avenir politique. La relation entre les hydrocarbures, la diplomatie et la politique intérieure russes est en fait bien plus nuancée que ne le laissent entendre ces déclarations ambiguës.
On connaît le poids actuel des hydrocarbures, et des matières premières en général, dans l’économie russe (35% du budget et 13% du PIB en 2003), leur influence sur le remboursement de la dette extérieure ramenée de 130% du PIB en 1998, au lendemain de la crise financière, à 40% cette année ! Depuis 2000, la Russie est devenue le troisième producteur mondial (9,1%) (mais seulement 4,6% des réserves estimées) et le deuxième exportateur de pétrole, et, surtout, le premier producteur (23%) et le premier exportateur mondial de gaz (34,7%). En 2001, sur les 100 plus grandes entreprises russes, près de 80% travaillent dans le secteur des hydrocarbures et des métaux non-ferreux . Pourtant, les difficultés d’exploitation du pétrole et du gaz liées à la géographie des gisements (froid, éloignement), la nécessité de construire à grands frais des tubes pour exporter ces hydrocarbures vers les nouveaux marchés émergeants asiatiques et la vétusté de ses raffineries, ne font pour l’instant pas de la Russie un acteur géostratégique d’importance mondiale au même titre que l’Arabie Saoudite, par exemple, mais l’un des facteurs, avec de nombreux autres (golfe de Guinée, Canada, Mexique, etc.) permettant l’augmentation de l’offre mondiale et donc favorisant, directement, les politiques de redéploiement énergétique des grands pays consommateurs, à commencer par les Etats-Unis.
Matières premières et hydrocarbures formatent donc le paysage économique et industriel de la Russie mais, au-delà, et par voie de conséquence, elles fragilisent aussi à l’extrême son économie et sa politique étrangère, comme le montre l’apparition de l’euro. Etant donné l’importance de l’Europe dans les achats d’hydrocarbures russes, la monnaie européenne pèse en effet lourd sur la dette extérieure du pays, au fur et à mesure qu’elle s’affermit par rapport au dollar. En 2003, Moscou sera ainsi obligé de rembourser un milliard de $ de plus pour compenser la différence des cours, au point que la Russie a dès à présent tout intérêt à tenter de réorganiser ses exportations d’énergie vers la CEI (paiement en roubles), les Etats-Unis et les marchés asiatiques. Le journal russe Nezavisimaya Gazeta n’hésite d’ailleurs pas ici à parler de « cataclysme économique ». L’influence énergétique russe sur l’Europe est donc à fortement minorer.
Plutôt qu’en Europe, ou ailleurs dans le monde, c’est en fait dans l’espace ex-soviétique, espace vital pour les intérêts stratégiques de Moscou, que l’on voit se déployer pleinement tous les instruments de l’influence russe, pour la plupart hérités de l’URSS. Ceux-ci montrent bien que les pays de la CEI, à l’exception notoire de l’Ukraine, n’ont jamais vraiment eu entre leurs mains les moyens de leur indépendance. Ils n’ont pu éviter, ces dernières années, comme sous l’effet d’une malédiction, de dériver vers l’orbite géopolitique et géoéconomique russe. Ces instruments sont multiples (fourniture d’armes, diaspora russe, coopération militaire, accueil des oppositions en exil, technologies particulières développées sous l’URSS, etc.), mais les principaux sont l’orientation sud-nord des oléoducs et gazoducs, qui a coupé, dès 1991, les pays de la CEI exportateurs d’hydrocarbures (Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Turkménistan et Kazakhstan) de l’accès direct à leurs marchés, le poids de la dette énergétique de ces pays envers la Russie, et, bien entendu, les holdings semi-publiques Gazprom et Transneft, dont le monopole, respectivement dans le transport du gaz et du pétrole, en fait des armes redoutables et redoutées.
Pour autant, ce monopole est sans doute en passe de s’effondrer. Transneft, qui opère à la limite de ses capacités, a reçu un premier coup avec l’autorisation récente accordée à Lukoil et Yukos de construire à Mourmansk un terminal pétrolier relié à leurs gisements - projet lui-même concurrencé par celui de Rosneft allié à Norilsk Nikel de développement du port d’Arkhangelsk( propriété de Norilsk) - et celle donnée à Yukos encore pour poser un oléoduc vers la Chine. Quant au monopole de Gazprom, qui pour l’instant se maintient grâce au refus de Poutine de le laisser privatiser et au faible prix intérieur du gaz russe, il pourrait exploser sous l’effet de la privatisation probable de SEU, la compagnie publique russe d’électricité, et, surtout, sous la pression de l’OMC qui tente d’obliger Moscou à aligner ses prix intérieurs sur les prix extérieurs dans le secteur du gaz. Dès lors, les grandes sociétés pétrolières qui, pour l’instant préfèrent brûler le gaz s’échappant de leurs puits de pétrole ou le réinjecter dans le sol, pourraient y voir un intérêt à venir chasser sur les terres de Gazprom.
L’incapacité des pays de l’ex-URSS à rembourser leurs dettes énergétiques à une Russie, qui possède le quasi-monopole des raffineries et la maîtrise des infrastructures de transport, a largement permis aux groupes russes de s’emparer de pans entiers de leur économie. Ce problème de la dette est devenu explosif à partir de la deuxième moitié des années 90, au moment où des sociétés russes, privatisées et émancipées de la tutelle de l’Etat, ont exigé de se faire rembourser. Il est en tout cas un facteur essentiel dans le processus de retour en force de la Russie dans son « étranger proche ».
Outils et acteurs de la politique intérieure russe
Avant d’être des outils potentiels de politique extérieure, les groupes pétroliers et gaziers sont avant tout des acteurs, parmi les plus importants, de la politique intérieure russe. On sait ainsi que Yukos-Sibneft finance le parti Yabloko et le parti communiste ; Rosneft, et peut-être Lukoil, Russie Unie (cette nébuleuse de partis et d’intérêts qu’il est convenu de qualifier de « pro-Kremlin ») ; Gazprom, Russie Unie également, mais aussi d’autres partis comme Yabloko ; Tatneft, le cinquième pétrolier russe, proche de Lukoil, finance La Patrie-Toute la Russie (OVR), le parti du maire de Moscou, Yuri Loujkov et de Boris Gryzlov, le ministre de l’Intérieur, et Régions de Russie, de M. Chamiyev, le président tatar, tous deux aujourd’hui composantes de Russie Unie. On se souvient aussi du rôle joué officiellement par Gazprom et Lukoil dans le démantèlement des empires médiatiques de B. Berezovskiy (ORT, TV-6, presse) et V. Gousinskiy (Media-Most) à partir de 2000, affaires dans lesquelles on retrouve, pêle-mêle, des acteurs mêlés de longue date à la politique et aux affaires : A.Tchubaïs, O.Deripaska, le FSB, Rem Viakhirev et V. Tchernomyrdine (tous deux anciens présidents de Gazprom), Video International, la plus grande agence de publicité russe, propriété du ministre des médias, Mikhaïl Lesin, etc., etc. La vente truquée des parts de l’Etat dans Slavneft, en décembre 1998, voit l’affrontement de R. Abramovitch (Sibneft) associé à TNK-Alfa contre Boris Grzyzlov, le ministre de l’Intérieur associé, lui, à des cadres du FSB et à la Mejprombank de Serguey Pougatchev, le fameux « banquier orthodoxe » proche de Poutine, c’est à dire à peu près les mêmes que dans l’affaire Yukos 7 mois plus tard. Gazprom (94% de la production de gaz russe en 2001), est l’exemple même de la nébuleuse politico-affairiste russe poussée à l’extrême, à la fois acteur social (il fournit du gaz aux régions russes à un prix dix fois inférieur aux prix européens), acteur de la politique intérieure et étrangère russe via ses infrastructures de transport, acteur médiatique aussi (chaîne de télévision, journaux), financier (11 banques) et militaire (usine du CMI). Plus généralement, ces géants des hydrocarbures, qui ne sont d’ailleurs presque toujours qu’une branche d’un empire bien plus grand (voir celui de V. Potanin, par exemple), contrôlent des régions et des pans entiers des administrations centrale et locales et il n’est pas rare qu’ils envoient leurs représentants siéger au Conseil de la Fédération depuis la réforme de cette institution par V. Poutine en août 2000.
La complexité de ces groupes, l’enchevêtrement de leur capital, leur poids dans la vie politique et économique viennent donc fausser l’analyse d’un monde oligarchique sur la défensive face à un Kremlin tout puissant qui les utiliserait à sa guise pour mener sa politique étrangère.
Indépendance et concurrence fratricide
Deuxième facteur qui va lui aussi contre l’idée d’une mainmise du pouvoir étatique, celui de l’intervention en CEI et sur son pourtour, voire au-delà (Irak), des multiples acteurs publics et privés russes du secteur des hydrocarbures qui vient très clairement s’y substituer à celle de l’Etat russe. Ceux-ci privilégient la croissance externe, notamment via le rachat d’entreprises étrangères, et une politique d’alliance avec les majors occidentales, autre facteur qui ne peut qu’encore marginaliser l’influence de l’Etat, pour peu que cette notion d’Etat ait un sens unique en Russie : TNK-Slavneft-Sidanko, le troisième ou quatrième pétrolier russe, est aujourd’hui largement un groupe russo-britannique depuis son alliance avec BP en février de cette année; quant à Yukos-Sibneft, qui pourrait bientôt fusionner avec ExxonMobil et ChevronTexaco, il est déjà largement dirigé par des Occidentaux : Bruce Misamor, son directeur financier, est ainsi un ancien cadre de la Pennzoil Co, une société texane qui compte l’ancien président Bush au nombre de ses actionnaires, tandis que le directeur de sa branche internationale n’est autre que Lord David Owen, l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères. Quant à la Lukoil, elle a acheté en 2000 la société américaine Getty Petroleum et en août 2001 des parts dans Bitech Petroleum Corporation, une société de prospection pétrolière canadienne. Gazprom, lui-même, a pour cabinet d’audit le cabinet américain Pricewaterhouse Coopers depuis 1996. On pourrait multiplier ces exemples d’alliances/partenariats à l’infini, mais y a-t-il pourtant meilleure preuve de l’indépendance des groupes énergétiques russes que le retrait, fin novembre 2002, de Lukoil de la Azerbaijan International Operating Company (AIOC) pour des raisons, probablement, de stratégie financière, alors que ce groupe était entré dans ce consortium en 1994 à la suite d’intenses pressions politiques russes sur l’Azerbaïdjan.
Dans la pratique cette multiplicité et ce jeu d’alliances débouchent aussi, de facto, et le parallèle avec le secteur des ventes d’armes est ici frappant, sur une concurrence russo-russe qui vient encore diluer un peu plus l’influence de l’Etat. Trois exemples de luttes fratricides. En Biélorussie tout d’abord où Gazprom et Transneft tentent, pour sécuriser leurs exportations, de prendre le contrôle de l’ensemble des infrastructures de transport de gaz et de pétrole, qui traversent le territoire biélorusse, en jouant sur la dette énergétique de Minsk (123 millions de $ au 1 août 2003), sur la fourniture de gaz au prix intérieur russe et en adoptant une lecture partisane des accords de Bichkek de 1992 donnant à la Russie la propriété de ces infrastructures, ce que refuse la Biélorussie. La manœuvre de Gazprom et de Transneft est simple : le premier obtient du premier-ministre russe, héraut du TEK, l’autorisation de multiplier par deux le prix de ses fournitures de gaz pour contrer le prix exorbitant (5 milliards de $) demandé par le président biélorusse pour un achat de la moitié des actions de la compagnie de transport national de gaz, Beltransgaz. Le second, Transneft, cesse d’approvisionner la raffinerie lettone de Ventspils, au bout de l’oléoduc biélorusse, dont il cherche à s’emparer au meilleur prix. Puis, malgré une protestation des pétroliers russes, qui craignent de voir monter le prix de leur production, dirige le pétrole vers le lointain terminal pétrolier que la Russie a commencé à construire en 1999 à Primorsk, provoquant ainsi une chute de la valeur des actions de Ventspils. Visiblement les deux cas sont liés et le travail de sape collectif.
Face à ce qu’il nomme un « chantage » russe, le président Lukachenko utilise plusieurs cartes : il refuse, le 12 septembre 2003, de signer l’accord sur la monnaie unique alors, qu’à Yalta, le débat sur la création d’une zone de libre échange est proche d’aboutir, fait saisir les 15% de parts de la raffinerie de Mozyr, propriétés des groupes Yukos-Sibneft et TNK, frappant ainsi au cœur le TEK russe, emprunte à la Libye l’argent de sa dette, mais surtout, contourne en partie l'ultimatum de Gazprom en passant des accords d'importation de gaz, sans doute par voie ferrée, avec TNK et Itera.
En Asie centrale, Gazprom tente, via ses achats de gaz à l’Ouzbékistan, de contrer la stratégie de développement d’Itera au Turkménistan. On peut bien entendu imaginer qu’à travers la politique de Gazprom c’est Moscou qui cherche à faire payer au Turkménistan l’annulation en début d’année de l’accord sur la double nationalité qu’il avait passé avec la Russie en 1992, mais à y regarder de plus près, le géant gazier cherche en fait à couper les exportations de gaz turkmène, exploité par Itera, via le gazoduc centre-asiatique, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan vers l’Ukraine et la Russie. Quant à l’Ouzbékistan, il peut, grâce à son accord avec Gazprom, prétexter un manque de capacité de ses tubes pour moduler selon son bon vouloir les exportations de son voisin. Il s’agit donc bien ici d’une symbiose : Gazprom profite de l’aide ouzbek pour chasser son rival financier et politique d’Asie centrale, tandis que les Ouzbeks affaiblissent leurs concurrents turkmènes qui ont passé un accord avec Itera pour transporter 36 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Ukraine. La duplicité de Gazprom est dans cette affaire totale puisque, parallèlement à ses manœuvres contre Itera, et preuve que sa stratégie n’est rien d’autre que financière, la société russe a conclu un accord de 25 ans avec le Turkménistan et s’est engagée à construire vers la Russie un gazoduc évitant … le territoire ouzbek et longeant la côte de la Caspienne via le Kazakhstan ! Un échec d’Itera au Turkménistan pourrait provoquer la faillite du groupe, d’autant plus qu’en Géorgie, pays où Itera est bien implanté, Gazprom est revenu en force le 28 mai 2003, au grand dam des Américains, via la création d’une joint-venture, GruzRosGazprom, qui se donne pour but de rénover les anciens tubes d’exportation soviétiques sur le sol géorgien, entreprise qui pourrait mettre à mal la viabilité économique du gazoduc Bakou-Erzurum. Avec le rachat par SEU en juillet d’une large partie du réseau électrique géorgien et le contrôle de l’armée russe sur la centrale électrique de Chegali en Abkhazie (IngurGes), le piège russe semble s’être totalement refermé sur une Géorgie au bord de la banqueroute et qui doit à présent réaliser qu’elle n’a décidément pas le choix de ses alliances.
En Russie même, Yukos, d’une part, et Transneft-Rosneft, d’autre part, s’affrontent pour désenclaver leurs gisements de Sibérie orientale : le premier en poussant à la construction d’un pipeline entre Angarsk (près du lac Baïkal) vers Daqing en Chine (Manchourie), les seconds entre la Sibérie et le port de Nakhodka, ce qui leur permettrait d’exporter leur production vers le Japon, la Corée et les Etats-Unis. La lutte entre les deux groupes a des implications géopolitiques sérieuses pour la Russie : la proposition de Yukos, qui semble devoir l’emporter, place la Chine en position de fixer ses conditions et d’entraver la libre exportation du pétrole de Sibérie.
Si l’utilisation des exportations d’hydrocarbures comme outil de la politique étrangère russe ne peut être écartée - la fourniture de gaz et de pétrole à prix réduits, voire à prix intérieurs russes (cas de la Biélorussie) peut être analysée sous cet angle – et même s’il est souvent difficile de tracer une frontière entre stratégie financière des entreprises et intérêts d’Etat, la politique de coercition directe pour atteindre un but politique telle que la Russie a pu la pratiquer dans le passé contre les pays baltes, par exemple, ne semble plus être la règle. La lutte autour de la Caspienne, la volonté de Moscou de couper le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et le Turkménistan des réseaux d’exportation occidentaux, les divers coups d’Etat qui ont frappé l’Azerbaïdjan dans le milieu des années 90 et l’exploitation par la Russie des conflits ethniques en Abkhazie et en Ossétie du Sud (Géorgie) et au Haut-Karabakh (Azerbaïdjan/Arménie) semblent d’un autre âge : l’intérêt bien compris de la Russie est aujourd’hui de stabiliser son espace immédiat, y compris autour de la Caspienne, même si les questions d’évacuation du pétrole et du gaz de cette mer/lac sont loin d’être réglées. Le « partenariat pétrolier » avec les Etats-Unis qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 et la création du Caspian Pipeline Consortium (CPC) dans lequel Rosneft et Lukoil sont parties prenantes, sont venus apaiser cette lutte en minorant l’importance de l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC). A mon sens, même la menace faite le 12 septembre 2002 par V. Poutine d’intervenir militairement dans la vallée géorgienne de la Pankisi doit plus être vue, même si elle coïncide avec le début de la construction du BTC, comme un message adressé aux Etats-Unis alors qu’ils s’apprêtent à intervenir en Irak sans mandat des Nations unies (« nous pouvons menacer vos intérêts économiques en Géorgie si vous venez à menacer les nôtres en Irak ») que comme un coup porté contre l’indépendance de la Géorgie. Le message de Poutine a d’ailleurs été appuyé par un déploiement sans précédent de la marine russe au large des îles de Socotra qui abritent un centre d’écoute de l’armée américaine.
L’actualité semble donc indiquer que les logiques financières des sociétés russes, alliées à des partenaires étrangers, sont en train d’apporter une stabilité salutaire à l’espace ex-soviétique. Mais n’est-ce pas là après tout que la mise en pratique des recommandations du concept de sécurité nationale de 1997 et de la doctrine de politique étrangère du 28 juin 2000 qui prônaient une intégration de la Russie dans l’économique mondiale et régionale : l’économie est le pivot de la sécurité russe et l’économie pour cette Russie paupérisée de ce début de XXIe siècle c’est tout d’abord les exportations de gaz et de pétrole. V. Loukin, ancien ambassadeur de Russie à Washington, aujourd’hui vice-président de la Douma, ne dit pas autre chose « Notre politique étrangère doit poursuivre notre but principal qui est de sécuriser les conditions extérieures favorables sur le long terme pour moderniser notre pays ». Avec les exportations d’armes, les hydrocarbures sont les seuls produits capables de permettre la réalisation d’une pareille politique.
Cette stabilité, épiphénomène du retour de la domination russe sur cet espace, est moins le résultat de manœuvres et de pressions politiques, que le résultat de l’efficacité des instruments hérités de l’URSS évoqués ci-dessus. Aussi est-ce sans recourir à une quelconque coercition que les entreprises russes se sont emparées de larges pans de l’économie de presque tous les pays de l’ex-URSS : les entreprises russes contrôlent ainsi, par exemple, près de 80% de l’économie de la Moldavie après restructuration de sa dette énergétique et grâce à l’octroi de taxes douanières avantageuses ; en Arménie, elles contrôlent 40% de l’électricité du pays ; en Ukraine, elles ont pris pied dans les industries pétrolières, métallurgiques et chimiques, TNK et Lukoil contrôlent les 4 principales raffineries du pays et ont fait main basse sur le réseau de distribution d’essence. Selon l’hebdomadaire russe Expert, près de « 60% des industries ukrainiennes pourraient à terme se retrouver sous contrôle russe » ; En Asie centrale, Moscou a aussi échangé une partie de la dette kirghize (1 milliard et demi de $ en décembre 2002) contre des participation dans des sociétés nationales d’extraction d’uranium. Les exemples sont innombrables.
La Russie a aussi appris à jouer de l’enclavement des pays de la CEI exportateurs d’hydrocarbures pour acheter à prix réduit leur production et la revendre sur les marchés extérieurs aux prix mondiaux, ce qui lui permet de retarder la rénovation de son réseau de pipelines détérioré à près de 50%, selon le ministère de l’énergie. Le gaz turkmène est ainsi, par exemple, acheté 44$ les 1000 mètre cubes et revendu en Europe au prix de 90 à 120 $, mais 21,5 $ sur le marché intérieur russe !
Depuis l’arrivée de V. Poutine au pouvoir, date de départ d’un accroissement sans précédent de la puissance des sociétés pétrolières et gazières nationales, la négociation et le compromis ont plus apporté à l’économie russe que les coups d’Etat à répétition des années 90 ; l’accord du 14 mai 2003 entre le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie sur le partage de la mer Caspienne en est l’exemple parfait. Si ces pays connaissent toujours heurts ethniques, sécessions et frondes régionales ce n’est pas le fait de la Russie dont les forces de maintien de la paix ont - faut-il le souligner ? - fortement contribué à empêcher des massacres interethniques de grande ampleur. La Russie, pour autant, n’entend pas baisser sa garde face aux incertitudes de l’évolution des situations politiques en Iran, en Azerbaïdjan et en Géorgie, comme en témoignent le renforcement incessant de sa flotte de Caspienne et ses réactions négatives lors de l’annonce faite en février 2003 par le Kazakhstan de créer une marine.
Depuis ces deux dernières années, la cadence des accords de coopération énergétique au sein de la CEI n’a cessé de s’accélérer : avec l’Ukraine, sur fond de réconciliation spectaculaire, pour le transit sur son sol de gaz turkmène et russe ; signature le 28 mai 2003 d’un accord de coopération stratégique entre la Géorgie et Gazprom, on l’a vu ; au Kazakhstan, développement en commun des champs géants du nord de la Caspienne ; « coopération stratégique » dans le secteur du gaz en Ouzbékistan en décembre 2002 ; accord de coopération en avril 2003 dans le domaine gazier avec le Turkménistan, suivi d’un accord de sécurité. Sans oublier les accords avec la Chine, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Turquie, les Etats-Unis, etc. La Russie, consciente que son développement économique est dangereusement dépendant de ses exportations d’énergie, cherche aussi à maîtriser, on l’a vu dans le cas biélorusse, les infrastructures de transport de ses hydrocarbures et à renforcer sa position dans ce secteur à la veille de l’élargissement de l’UE. Les efforts faits pour contourner l’obstacle du Bosphore en construisant un pipeline vers la Bulgarie (Burgas) et la Grèce (Alexandropoulos) et les investissements de Lukoil en Europe balkanique, sont ici symptomatiques.
Tous ces accords ne sont en fait rien d’autre que la partie visible d’une architecture économique plus générale : appel en janvier 2002 de V. Poutine à la création d’une « alliance eurasienne des producteurs de gaz », remise en service probable d’une ligne de chemin de fer entre le sud de la Russie et l’Arménie à travers le territoire géorgien, projet de raccordement de la péninsule coréenne aux infrastructures portuaire, aéroportuaire, ferroviaire russe, en partie sous l’égide de l’UNDP (United Nations Development Program), signature à Yalta en septembre dernier d’un accord de création d’une zone de libre échange avec la Biélorussie, l’Ukraine et le Kazakhstan, l’ensemble venant s’appuyer sur la mise en place d’organisations sécuritaires comme l’Organisation de coopération de Shanghai en juin 2001, par exemple. Aujourd’hui toute la politique étrangère russe concourre à faire oublier la stratégie d’obstruction systématique et stérile menée par un B. Eltsine agonisant et elle est très largement le fait des lobbies énergétiques. Grâce au succès de cette politique, la Russie est en train de réussir à reformer autour d’elle un ensemble économique cohérent, stable et, pour tout dire, largement à sa botte.
Cyrille Gloaguen
Institut Français de Géopolitique (Paris VIII)
English summary
he Influence of Hydrocarbons on Russian Foreign Policies as a Mean of Cooperation or Coercion.
Author
: Cyrille Gloaguen is a doctoral research fellow with the French Institute of Geopolitics (University of Paris 8, Saint-Denis).Hydrocarbon economics and policies weigh heavily on Russian home policy and international relations. Both instrumental and instrumented, raw material and hydrocarbon exports make Russia a key geostrategic player on the world's chessboard. The semiotics of these fluctuations shade some light on forces at work in home and regional matters. Cyrille Gloaguen here presents an intertextual approach into the dynamics of this subject, the problematics of which has recently been surfacing in the Western media.